Longtemps considérée comme une curiosité historique, la déflation est pourtant revenue hanter les économies avancées depuis la crise financière mondiale. L’Europe, à l’orée de 2015, n’échappe pas à cette menace. Le souvenir du Japon des années 1990 — marquées par une spirale déflationniste durable — offre un précédent inquiétant. Comprendre les mécanismes de la déflation, ses risques et les moyens d’y échapper est plus crucial que jamais.
Déflation, premier acte : la chute des prix
Historiquement, la déflation désigne une baisse simultanée de la production et du niveau des prix, souvent alimentée par une contraction du crédit. Le Japon de l’entre-deux-guerres, puis celui des années 1990 après l’éclatement de sa bulle immobilière, en offrent des exemples saisissants. À cette époque, la Banque du Japon, lente à réagir, finit par abaisser ses taux d’intérêt à zéro et inonda le marché de liquidités pour tenter — en vain — de recréer de l’inflation.

Aujourd’hui, la zone euro connaît à son tour des signes avant-coureurs. Comme l’illustre le graphique 1, la chute des prix de l’énergie, d’environ 2 % en rythme annuel, alimente une “déflation locale”.
Si l’on exclut l’énergie, l’inflation sous-jacente, qui mesure l’évolution des prix hors éléments volatils1 (énergie et produits alimentaires), reste positive mais faible : à 0,4 % sur un an en octobre 2014, elle reste bien loin de la cible des 2 % fixée par la Banque Centrale Européenne (BCE).
La chute des prix de l’énergie exerce une pression directe sur les indicateurs d’inflation, mais c’est l’inflation sous-jacente qui révèle la dynamique structurelle de l’économie. Et son niveau actuel témoigne d’une demande interne atone.
Déflation, second acte : l’économie au ralenti
La déflation n’est pas qu’une histoire de prix. Elle est souvent le symptôme d’une économie stagnante.

La zone euro, au troisième trimestre 2014, n’a progressé que de 0,2 % par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation rapide d’Eurostat. Cette croissance, fragile et sujette à révision, fait suite à une hausse anémique de 0,1 % au deuxième trimestre. Sur un an, le PIB n’a crû que de 0,8 %.
Cette quasi-stagnation est préoccupante : en l’absence d’une croissance soutenue, l’inflation reste durablement faible, le chômage reste élevé, et la capacité de désendettement des États et des ménages s’érode. La spirale déflationniste menace alors de s’enclencher : la baisse des prix freine la consommation et l’investissement, renforçant la stagnation.
Pourquoi la politique monétaire est-elle presque impuissante ?
Face à ces risques, la politique monétaire semble désarmée. Les baisses successives des taux directeurs de la BCE et l’annonce de programmes de rachats d’actifs n’ont eu qu’un impact limité, notamment dans les pays du “noyau dur” de la zone euro.

Plusieurs raisons à cela :
- En zone euro, les banques restent les principaux fournisseurs de crédit, contrairement aux États-Unis où les marchés financiers jouent un rôle plus central. Les politiques de taux bas ou d’achat d’actifs influencent donc moins efficacement la distribution de crédit.
- Les rachats d’obligations souveraines, d’entreprises ou de titres adossés à des actifs ont un effet amoindri dans une économie sur-bancarisée.
- Enfin, même l’arme du taux de change — par le biais d’un euro plus faible — se heurte aux réalités d’un énorme excédent commercial de la zone euro, qui limite l’ampleur de toute dépréciation monétaire.
Le spectre japonais : l’Europe face au piège de la déflation
Le parallèle avec le Japon n’est pas qu’une vue de l’esprit. À Tokyo, les années 1990 ont vu une croissance molle, une inflation nulle, une explosion de la dette publique… et une société entrée dans un long sommeil économique.
L’Europe est-elle condamnée au même sort ?
Il reste une différence importante : l’expérience japonaise a servi de leçon, et les autorités européennes sont aujourd’hui bien conscientes des dangers d’une déflation non maîtrisée.
Mais certaines zones de la zone euro sont déjà tombées dans ce piège : en 2013, la Grèce a connu une chute simultanée de la production et du niveau des prix, véritable cas d’école d’une déflation locale.
Comment éviter la spirale déflationniste ?
Il est encore temps d’agir, mais cela nécessite une mobilisation coordonnée de tous les leviers de politique économique.
Parmi les solutions possibles :
- Stimulus budgétaire ciblé : L’assouplissement monétaire doit être accompagné d’une relance budgétaire, particulièrement dans les pays disposant de marges de manœuvre fiscales.
- Réformes structurelles : Favoriser l’investissement privé en assouplissant certaines contraintes réglementaires, notamment sur les marchés du travail et des biens.
- Coopération monétaire et budgétaire : Ne pas laisser la BCE seule en première ligne. Une action concertée, entre politique monétaire accommodante et budgets expansionnistes, est nécessaire pour relancer la demande.
- Communication forte des autorités : Ancrer fermement les anticipations d’inflation à moyen terme pour éviter l’enracinement d’une “psychologie de déflation” dans les entreprises et les ménages.
Sans action rapide et résolue, l’Europe pourrait se retrouver, à l’instar du Japon, enfermée dans une décennie perdue.
Conclusion
La déflation n’est pas seulement un risque économique ; c’est aussi une menace politique et sociale. Elle exacerbe les inégalités, renforce les populismes et affaiblit la cohésion sociale.
Face aux premiers signes de déflation, l’inaction n’est pas une option. L’histoire nous enseigne que prévenir la déflation est toujours moins coûteux que d’en sortir. La zone euro a aujourd’hui une opportunité précieuse : il serait tragique de la gaspiller.
- Voir eurostat.ec.europa.eu ↩︎
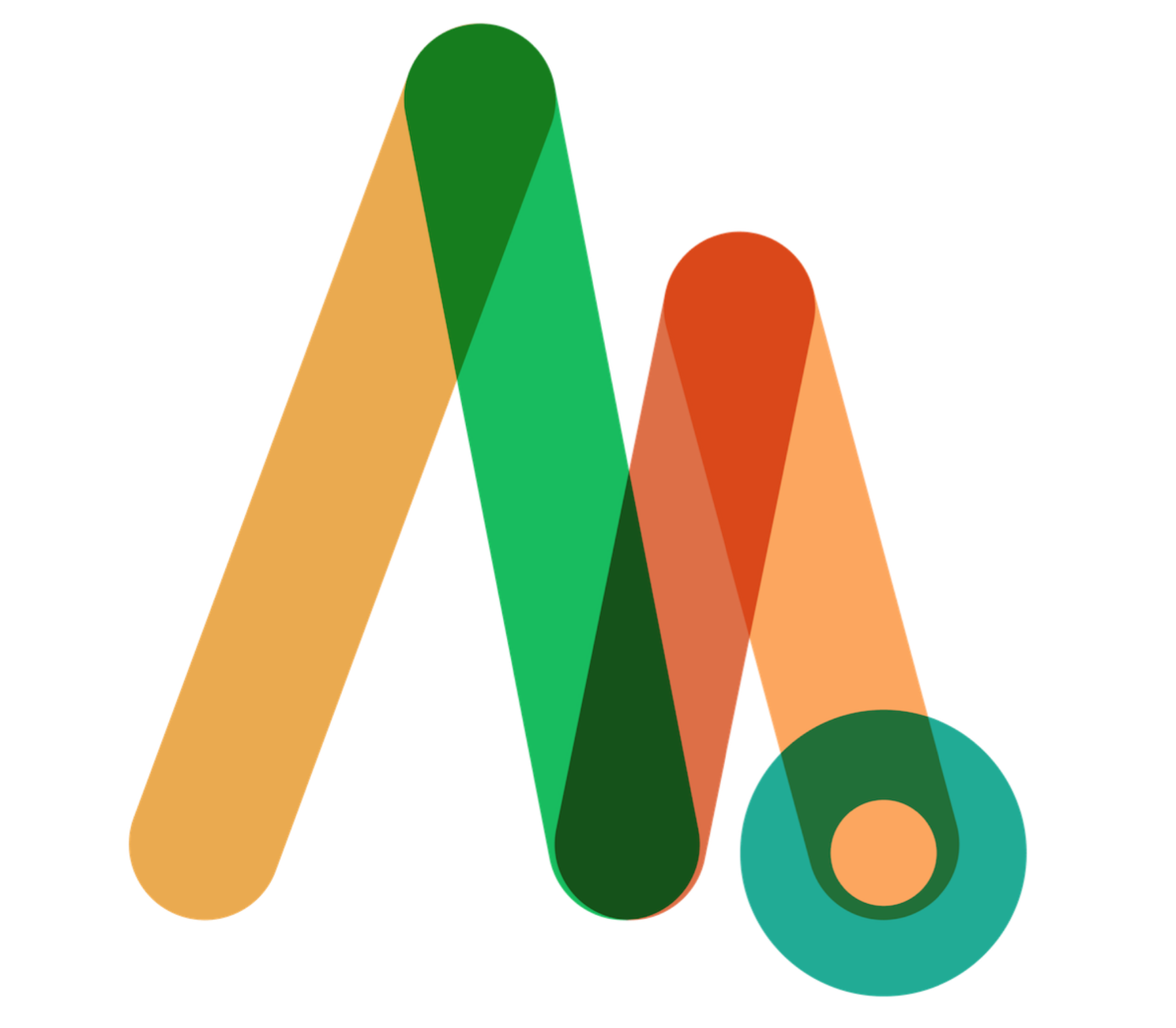



Laissez un commentaire